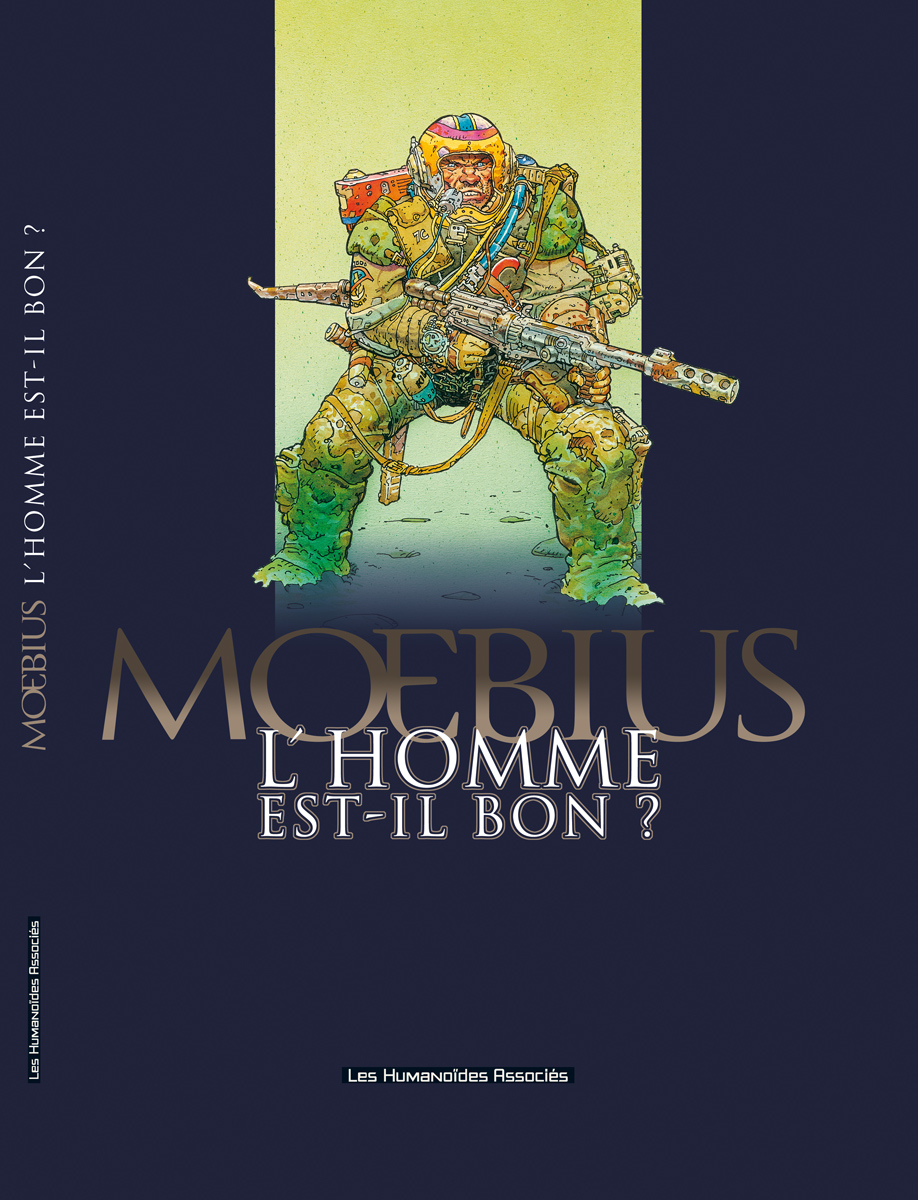L'Œuf du serpent
L'Œuf du serpent un chef d’œuvre de terreur sur la Terreur
(The Serpent's Egg) est un film allemand réalisé par Ingmar Bergman, sorti en 1977.
Le titre fait référence à une tirade de Brutus dans Jules César de Shakespeare:
And therefore think him as a serpent's egg / Which hatch'd, would, as his kind grow mischievous; / And kill him in the shell

Dans l'Allemagne de 1923, l'antisémitisme, la misère et le chômage prennent de l'ampleur et Adolf Hitler prépare le coup d'état de Munich. Ancien artiste de cirque d'origine juive, Abel Rosenberg est interrogé par la police à propos du suicide de son frère. Très vite, il apprend que plusieurs de ses connaissances se sont étrangement suicidées d'une manière violente. Suspecté, Abel trouve de l'aide auprès de Manuella, la femme de son frère. Autour d'eux, le monde sombre dans la folie. Lorsque Manuella et Abel vont comprendre les véritables enjeux de ses morts mystérieuses, il sera trop tard...
Réalisation Ingmar Bergman
Scénario Ingmar Bergman
Acteurs principaux
David Carradine,
Liv Ullmann,
Heinz Bennent,
Gert Fröbe
Sociétés de production
Dino De Laurentiis et Horst Wendlandt
Pays d’origine Allemagne
Durée 120 minutes
L’œuf du Serpent est complètement nourri de visions de cauchemars. Dans ses meilleurs moments c’est un film d’Histoire assez unique dans sa réflexion sur les mécanismes mentaux de la terreur et le terrassement de l’être humain qu’elle laisse profiler. Dans ses décors le cinéaste préfère figurer l’Histoire dans sa dimension abstraite, la revisitant au travers des dédales de rues glauques et d’archives souterraines et labyrinthiques. Recyclant avec Sven Nykvist les imageries de l’expressionisme en les agrémentant d’une dimension poisseuse, il flirt au final plus souvent avec l’ambiance d’un Kafka, créant une vision de l’Allemagne de l’époque qui ne ressemble à aucune autre dans le 7ème art. Son obsession plus précise pour les esthétiques de la pellicule, sur le plan de la représentation du mental, offre avec Persona certaines de ses images les plus obsédantes et traumatisantes en la matière. Dans quel but ? Bergman semble vouloir nous montrer dans ce film deux choses : tour à tour l’apathie la plus extrême dans laquelle peut tomber une société, et parallèlement aussi comment le corps et le
mental humain peuvent-être repoussés au bout de leurs limites pour un sursaut sous le signe de la haine.


C’est de cette confrontation paradoxale que se nourrit un mal invisible à nos yeux, idéalisme radical né du désespoir. Sans ce travail inclusif faisant office d’expérience de cinéma sur le spectateur, le « discours » du film pourrait paraître une leçon de plus sur « la bête » dans l’Histoire, et somme tout un peu simpliste surtout via la métaphore du titre. Mais ce qui pousse à la réflexion et à la profondeur, c’est le ressenti produit via notre propre acceptation de ces images… ainsi que l’idée que les expériences à l’œuvre ici sont assez limitrophes avec un plaisir que pourrait ressentir l’auteur/cinéaste lui-même à pousser à bout ses acteurs ; voire son spectateur.

Le savant fou précurseur des pires atrocités rationalistes du IIIème Reich fabrique ici un spectacle en images qui n’est pas loin d’être un abyme de ce qu’inflige le metteur en scène à ses personnages en mettant à nu leurs fonctionnements et poussant à bout le comportemental. On peut se sentir troublé si l’on se réfère en prime à une courte période de la vie de Bergman où lui-même fut séduit par ces idées du national-socialisme. Le film est-il pour lui le moyen de régler certains comptes avec sa culpabilité, des démons intimes ? Cette ambiguïté ici est d’autant plus forte que le film propose depuis son amorce une angoisse liée au regard impromptu et dérangeant, où chacun se traque de façon quasi pornographique et opaque avant que ne se révèle une caméra derrière le miroir, bruit de « moteur »… C’est comme si le metteur en scène dépouillait la puissance mais aussi l’ambiguïté de sa méthode, et d’une façon très directe. Dans ces instants, le film donne même parfois le sentiment d’évoquer aussi le statut de l’Allemagne de l’Est en 1977 et son système de surveillance de l’intime.

chef d’œuvre de terreur sur la Terreur
(The Serpent's Egg) est un film allemand réalisé par Ingmar Bergman, sorti en 1977.
Le titre fait référence à une tirade de Brutus dans Jules César de Shakespeare:
And therefore think him as a serpent's egg / Which hatch'd, would, as his kind grow mischievous; / And kill him in the shell

Dans l'Allemagne de 1923, l'antisémitisme, la misère et le chômage prennent de l'ampleur et Adolf Hitler prépare le coup d'état de Munich. Ancien artiste de cirque d'origine juive, Abel Rosenberg est interrogé par la police à propos du suicide de son frère. Très vite, il apprend que plusieurs de ses connaissances se sont étrangement suicidées d'une manière violente. Suspecté, Abel trouve de l'aide auprès de Manuella, la femme de son frère. Autour d'eux, le monde sombre dans la folie. Lorsque Manuella et Abel vont comprendre les véritables enjeux de ses morts mystérieuses, il sera trop tard...
Réalisation Ingmar Bergman
Scénario Ingmar Bergman
Acteurs principaux
David Carradine,
Liv Ullmann,
Heinz Bennent,
Gert Fröbe
Sociétés de production
Dino De Laurentiis et Horst Wendlandt
Pays d’origine Allemagne
Durée 120 minutes
L’œuf du Serpent est complètement nourri de visions de cauchemars. Dans ses meilleurs moments c’est un film d’Histoire assez unique dans sa réflexion sur les mécanismes mentaux de la terreur et le terrassement de l’être humain qu’elle laisse profiler. Dans ses décors le cinéaste préfère figurer l’Histoire dans sa dimension abstraite, la revisitant au travers des dédales de rues glauques et d’archives souterraines et labyrinthiques. Recyclant avec Sven Nykvist les imageries de l’expressionisme en les agrémentant d’une dimension poisseuse, il flirt au final plus souvent avec l’ambiance d’un Kafka, créant une vision de l’Allemagne de l’époque qui ne ressemble à aucune autre dans le 7ème art. Son obsession plus précise pour les esthétiques de la pellicule, sur le plan de la représentation du mental, offre avec Persona certaines de ses images les plus obsédantes et traumatisantes en la matière. Dans quel but ? Bergman semble vouloir nous montrer dans ce film deux choses : tour à tour l’apathie la plus extrême dans laquelle peut tomber une société, et parallèlement aussi comment le corps et le
mental humain peuvent-être repoussés au bout de leurs limites pour un sursaut sous le signe de la haine.


C’est de cette confrontation paradoxale que se nourrit un mal invisible à nos yeux, idéalisme radical né du désespoir. Sans ce travail inclusif faisant office d’expérience de cinéma sur le spectateur, le « discours » du film pourrait paraître une leçon de plus sur « la bête » dans l’Histoire, et somme tout un peu simpliste surtout via la métaphore du titre. Mais ce qui pousse à la réflexion et à la profondeur, c’est le ressenti produit via notre propre acceptation de ces images… ainsi que l’idée que les expériences à l’œuvre ici sont assez limitrophes avec un plaisir que pourrait ressentir l’auteur/cinéaste lui-même à pousser à bout ses acteurs ; voire son spectateur.

Le savant fou précurseur des pires atrocités rationalistes du IIIème Reich fabrique ici un spectacle en images qui n’est pas loin d’être un abyme de ce qu’inflige le metteur en scène à ses personnages en mettant à nu leurs fonctionnements et poussant à bout le comportemental. On peut se sentir troublé si l’on se réfère en prime à une courte période de la vie de Bergman où lui-même fut séduit par ces idées du national-socialisme. Le film est-il pour lui le moyen de régler certains comptes avec sa culpabilité, des démons intimes ? Cette ambiguïté ici est d’autant plus forte que le film propose depuis son amorce une angoisse liée au regard impromptu et dérangeant, où chacun se traque de façon quasi pornographique et opaque avant que ne se révèle une caméra derrière le miroir, bruit de « moteur »… C’est comme si le metteur en scène dépouillait la puissance mais aussi l’ambiguïté de sa méthode, et d’une façon très directe. Dans ces instants, le film donne même parfois le sentiment d’évoquer aussi le statut de l’Allemagne de l’Est en 1977 et son système de surveillance de l’intime.

chef d’œuvre de terreur sur la Terreur